- Type d'objet
- chasuble
- Lieu de production
- Angleterre
- Période de création
- 4e quart du XVe siècle / 1er quart du XVIe siècle
- Interventions postérieures
remontage et remaniements au XIXe ou au XXe siècle
- Fond
- velours de soie rouge (fond de l'ornement, XIXe siècle ou postérieur), satin de soie rouge-rose (doublure, récente), toile en fibres végétales (lin ?) (fond de l'orfroi)
- Matériaux de la broderie
- filés or (argent doré), filés argent, cordonnets de soie guipés d'un trait métallique riant, fils de soie polychromes
- Passementerie
- galon or (récent)
- Techniques de la broderie
- broderie de rapport, couchure, couchure à effet de bâtons rompus, couchure à effet de losanges, passé empiétant, passé plat, point d’Orient, point de Boulogne, point fendu, point lancé
- Dimensions
-
objet (dos) : h. 113,7 cm ; la. 71 cm
objet (devant) : h. 112 cm ; la. 50,8 cm
orfroi (croix, dos) : h. 109 cm ; la. (traverse) 57,8 cm ; la. (pied) 24,5 cm
orfroi (colonne, devant) : h. 86,1 cm ; la. 23,7 cm
galon : la. 3,3 cm
- Provenance
- Hautvilliers-Ouville, sacristie de l'église Notre-Dame de l'Assomption, déposée au trésor de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens le 28 juillet 1986
- Lieu de conservation
- Hauts-de-France, Somme, Amiens, cathédrale Notre-Dame
- Numéro d'identification
- Ch 132
Notice
L'objet et son iconographie
Cette chasuble était conservée dans l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Hautvilliers-Ouville jusqu'en 1986, date de sa mise en dépôt au trésor de la cathédrale d'Amiens. Elle est ornée, au dos, de la Crucifixion (surmontée de la colombe du Saint-Esprit et cantonnée de deux anges recueillant dans trois calices le sang s'écoulant des plaies du Christ), d'un prophète et d'un saint Paul identifiable à ses attributs : le livre et l'épée. La colonne du devant porte trois personnages avec, de haut en bas, un prophète, saint Barthélemy tenant le livre et le couteau, et Moïse, cornu, serrant son bâton dans la main gauche et les tables de la loi dans la droite. Réappliqués à une date inconnue sur un fond de velours rouge, qui ne peut être antérieur au XIXe siècle, ces orfrois ont été partiellement rebrodés et agrémentés de galons datant de l'époque du remontage. La partie supérieure de la Crucifixion et celles inférieures du saint Paul et du Moïse ont été amputées afin de s'adapter à la nouvelle forme du vêtement, tandis que des chutes de la broderie ont été insérées au niveau du col aux côtés de morceaux d'étoffes plus récentes.
Des orfrois brodés en Angleterre
Chacune des figures est inscrite dans une architecture bien caractérisée formée de deux piles percées de niches en plein cintre et surmontées d'une muraille devant un toit à double pentes dont les murs pignons sont à fenêtres. Les canons des personnages (trapus, aux nez droits, aux visages oblongs), la forme particulière des arcatures ainsi que l'iconographie, mêlant prophètes et saints personnages, conduisent à rattacher ces orfrois à un corpus cohérent de broderies produites en Angleterre entre 1490 et 1525. On peut ainsi les rapprocher de ceux d'une chasuble conservée au Victoria & Albert Museum de Londres (T. 26-1922), d'une deuxième au musée d'Écouen (E. Cl. 2205) et d'une autre appartenant aux collections du musée Dobrée de Nantes (857.2.1). La proximité des motifs trahit le recours à des modèles communs dans le cadre d'une production d'ornements en série en plein essor en Occident à la fin du Moyen Âge. Parmi eux, ceux brodés en Angleterre ont récemment fait l'objet d'un réexamen par Kate Heard[1].
Le témoin d'une production sérielle d'ornements liturgiques
Alors qu'entre 1250 et 1350 les ateliers d'outre-Manche étaient internationalement réputés pour la création de textiles liturgiques de grand luxe désignés par le terme d'opus anglicanum dans les inventaires papaux, d'importantes évolutions sont à noter au XVe siècle, dont témoignent les broderies de la chasuble d'Hautvillers-Ouville. Les décors, qui couvraient jusqu'alors toute la surface des ornements, se concentrèrent au niveau des bandes d'orfrois, fixées sur des fonds de velours unis ou façonnés. Les figures, réalisées à part sur toile à l'aide de poncifs, y étaient rapportées, puis associées aux fonds d'or et aux architectures. Ce mode de production standardisée, fruit d'un travail réparti entre plusieurs ouvriers, permettait aux ateliers de répondre à une demande croissante due à la multiplication des fondations de messes par des particuliers et des confréries. À la suite du schisme anglican au XVIe siècle, les broderies anglaises produites au cours de cette période furent massivement vendues sur le continent. Ce commerce, bien documenté par les archives[2], permet d'expliquer pourquoi il en subsiste un nombre relativement important dans les sacristies des cathédrales et des églises de France et de Belgique[3].
Astrid Castres
[1] Kate Heard, « “All Holie Companye of Heaven”: Uniformity and Individuality in the Iconography of English Late Medieval Orphreys », dans Evelin Wetter (dir.), Iconography of Liturgical Textiles in the Middle Ages, Berne, Abegg-Stiftung, 2010, p. 155-162 et ead., « Ecclesiastical Embroidery in England from 1350 to the Reformation », dans Clare Browne, Glyn Davies et Michael Michael (dir.), English Medieval Embroidery. Opus Anglicanum, catalogue de l'exposition [Londres, Victoria & Albert Museum, 1er octobre 2016-5 février 2017], New Haven/Londres, V&A, 2016, p. 77-89.
[2] Voir notamment Catherine Grodecki, Histoire de l'art au XVIe siècle (1540-1600), t. 2, Paris, Archives nationales, « Documents du Minutier central des notaires de Paris », 1986, n° 892, p. 235.
[3] On renvoie le lecteur au corpus rassemblé par Josiane Pagnon, dans File le temps, reste le tissu. Ornements liturgiques de la Manche, Saint-André-de-Bohon, Conservation des antiquités et objets d'art de la Manche, 2007, p. 66-67.



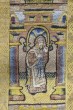
Bibliographie
Le trésor de la cathédrale d'Amiens, Amiens, Association Trésor de la Cathédrale d'Amiens, 1987, n° 76.
Pontroué, Pierre-Marie (dir.), Trésors en pays de Somme. Art religieux XIIe-XXe, catalogue de l'exposition [Saint-Riquier, musée départemental de l'abbaye, 7 juin-16 novembre 1997], s. l., conservation départementale des antiquités et objets d'art/conseil général de la somme, 1997, n° 121, p. 60-61.
Pagnon, Josiane, File le temps, reste le tissu. Ornements liturgiques de la Manche, Saint-André-de-Bohon, Conservation des antiquités et objets d'art de la Manche, 2007, p. 66, n. 53, p. 67, fig. 107.
